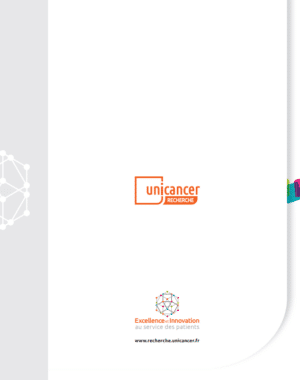Fondé sur l’excellence, le modèle Unicancer repose sur une prise en charge globale, pluridisciplinaire et innovante qui permet l’implication des patients à toutes les étapes de leurs parcours. Du dépistage jusqu’au suivi après traitement, cette dynamique partenariale est formalisée dans une Charte que l’ensemble des CLCC font vivre au quotidien.
Un modèle partagé formalisé dans une Charte
Accueillant plus de 600 000 patients chaque année, les Centres de lutte contre le cancer partagent un même modèle de prise en charge et d’accompagnement des patients.
un même modèle de prise en charge
Charte à destination des patients
cette Charte : solidarité,
humanisme, innovation et excellence
Ce modèle global et innovant se base sur :
- la qualité de la prise en charge
- l’intégration pleine et entière de l’« expérience patient »
- un type de gouvernance associant souplesse et réactivité
La stratégie d’Unicancer porte et renforce le caractère unique de ce modèle, qui prend en compte les différentes spécialités liées à la lutte contre le cancer, l’ancrage universitaire et la complémentarité des expertises de chaque Centre au sein de notre réseau.
Depuis 2019, le modèle Unicancer est formalisé dans notre Charte d’engagements à destination des patients, qui leur garantit un parcours de soins de qualité et accessible, en leur fournissant des informations essentielles sur les conditions de leur prise en charge au sein du réseau Unicancer. Une Charte qui démontre notre exigence de transparence et d’interactivité dans la relation entre nos Centres, les patients et leurs proches.

« Unicancer promeut les actions permettant aux patients d’être acteurs de leur prise en charge, en décision partagée avec les professionnels de santé. Leur participation à la définition et à l’évaluation de leur propre parcours de santé est indispensable pour améliorer la pertinence et la qualité des soins. »
Sophie Beaupère, Déléguée Générale d’Unicancer
Parcours de soins et qualité de vie
Des innovations au service de la prise en charge
Avant-gardistes depuis toujours, les CLCC collaborent activement pour identifier les principales évolutions de la cancérologie et changer les pratiques, afin de garantir aux patients un accès rapide aux évolutions en cours dans les domaines des traitements, des soins et de la recherche.
Par exemple, dans le cadre du parcours des soins et de la qualité de vie des patients, notre réseau a mis en place des initiatives très innovantes. Via son « Groupe prévention », Unicancer vise à faire de la prévention un pilier à part entière de son modèle de prise en charge, notamment à travers la prévention personnalisée pour nos patients dans les trois types de prévention (primaire, secondaire, tertiaire). Les innovations thérapeutiques passent aussi nécessairement par la recherche, l’un des piliers de l’action d’Unicancer et des CLCC, et notamment les essais cliniques.
Innovation pour le cancer au cœur des Centres
Intégrer un essai clinique
(vs. 8,5 % en moyenne dans les établissements de santé français)
S’ils en ont et en expriment le souhait, les patients de nos Centres ont l’opportunité d’intégrer un essai clinique en fonction de leur cancer et de leur traitement.
Considérant le patient comme partenaire, aussi dans le domaine de la recherche clinique, Unicancer a mis en place des Comités de patients en recherche clinique en cancérologie, en partenariat avec la Ligue nationale contre le cancer. Ces Comités sont composés de patients et de proches et visent à :
- Optimiser la qualité de l’information délivrée aux patients avant toute entrée dans un essai
- Suggérer des évolutions des pratiques pour améliorer le confort des patients
- Humaniser les essais cliniques